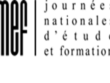Rappels de la partie 1 sur les points essentiels de cette réforme :
Points positifs :
- Si la réforme vise à actualiser les diplômes et à les adapter aux besoins contemporains, ce qui est essentiel pour répondre aux défis sociétaux actuels. Cette réforme vise surtout à construire les diplômes à partir des mêmes structurations pour chacun des diplômes afin de faciliter les passerelles et les allégements de formation dans le cadre de la formation tout au long de la vie ;
- La création de blocs de compétences offre plus de flexibilité et des passerelles entre les métiers, facilitant la reconversion et la progression professionnelle. Toutefois, les blocs existent déjà, prenant la place des Domaine de Compétences, c’est la logique d’acquisition du diplôme qui change, puisqu’il faut acquérir tous les blocs pour être diplômé, là où il y avait une moyenne de deux blocs pour acquérir un DC.
Points négatifs :
- La mise en place de cette réforme peut être complexe et coûteuse pour les établissements de formation, nécessitant des ressources supplémentaires pour l’adaptation des programmes ;
- Il existe un risque de standardisation excessive, qui pourrait nuire à la spécificité de certaines formations et à l’identité professionnelle des travailleurs sociaux.
Comment s’organise la construction des diplômes par bloc :
Cela concerne tous les métiers de diplôme d’État. Il est ainsi mis à l’étude une réorganisation de chaque diplôme à partir d’un modèle qui se veut selon ses promoteurs homogène et cohérent. Il s’agit de proposer qu’à l’avenir tous les diplômes du travail social soient construits sur la base de 4 blocs de compétence :
- Un bloc transversal : Il comprend des savoirs de base, des aptitudes comportementales, organisationnelles ou cognitives, et des savoirs généraux communs aux métiers ou aux situations professionnelles
- Deux blocs communs : qui organisent les compétences communes à l’ensemble des professionnels du travail social tout en les inscrivant dans les contextes d’intervention particuliers du diplôme – métier – fonction visés. Ils sont censés correspondre au cœur des métiers de la cohésion sociale et regroupent leurs principes d’action communs
- Un bloc spécifique : qui déploie les compétences singulières pour chaque diplôme. Ce bloc représenterait la singularité de chaque diplôme ou métier et de ses pratiques professionnelles particulières.
- Seconde partie.
Cela préfigure-t-il un chemin vers le travailleur social unique ? Non précise le bureau des professions sociales qui porte ce projet. Il ne s’agit en aucun cas de modifier les Diplômes d’État, mais bien de réorganiser les cursus des formations afin de les rendre plus lisibles et de permettre des passerelles entre tous les métiers de même niveau.
- Une réforme qui vise à faciliter les passerelles
La démarche engagée poursuit plusieurs objectifs assez ambitieux. En premier lieu, il s’agit de favoriser le décloisonnement des métiers tout en préservant les identités professionnelles spécifiques. Cette approche vise à clarifier ce qui est commun à l’ensemble des travailleurs sociaux et ce qui relève des compétences particulières de chaque spécialité. Un autre enjeu majeur est le renforcement de la mobilité professionnelle. En facilitant les passerelles entre les différents diplômes d’État du travail social, voire avec d’autres certifications proches, la réforme entend fluidifier les parcours et offrir davantage d’opportunités aux professionnels du secteur.
La valorisation et l’attractivité des métiers du travail social est aussi un argument avancé pour cette réforme. Dans un contexte de difficultés de recrutement, le projet consiste à vouloir rendre ces professions plus visibles et attrayantes, tant pour les jeunes en formation initiale que pour les personnes en reconversion professionnelle. Devons-nous être convaincu par cet argument ? sans revalorisation salariale, ni une réorganisation du contenu du travail par les employeurs, une simple réorganisation de la formation ne permettra pas cette revalorisation. Pour autant elle pourrait y contribuer.
- Des avantages avec des points de vigilance à prendre en considération
Cette réorganisation des blocs de formations révèle plusieurs avantages potentiels. Tout d’abord, la nouvelle architecture permet de visualiser clairement la transversalité des compétences. L’accent mis sur le partenariat et le territoire reflète l’évolution des pratiques vers une approche plus globale et ancrée localement, une tendance déjà amorcée dans les réformes précédentes.
L’introduction de la notion d’autodétermination est particulièrement bienvenue, car elle correspond aux tendances actuelles du travail social et vise à développer le pouvoir d’agir des personnes accompagnées. Ces orientations devraient particulièrement être en résonance avec les métiers de l’aide et de l’assistance de niveau 6, tels que les assistants de service social et les conseillers en économie sociale et familiale. Les principes de l’autodétermination ne sont pas l’exclusive des niveaux 6. Ils sont les incontournables socles de toute pratique de l’intervention sociale, pour tous les travailleurs sociaux.
Cependant, il faut aussi soulever plusieurs points de vigilance. Il existe un risque de dilution des spécificités de chaque métier dans un tronc commun trop large. Pour répondre à ces inquiétudes, il sera essentiel de préciser le temps dédié à chaque bloc de compétence, afin de garantir que la spécificité de chaque métier soit préservée. Le fait de rappeler la spécificité d’un métier renvoie à une logique/structuration historique (pré/historique) du secteur. Les médecins sont des médecins et ils font une spécialisation. Mais ils sont d’abord des médecins. Ce qui leur permet certainement de travailler ensuite ensemble autour du projet de soin du patient. Spécificité renvoie encore trop à identité.
De plus, il faut être attentif aux différences d’interprétation possibles d’un même objectif ou moyen selon les métiers et missions. Par exemple, la notion de « mobiliser les ressources » pourrait être perçue différemment selon les contextes professionnels. Il est donc essentiel que ces blocs soient déclinés de manière spécifique pour chaque diplôme d’État, afin de respecter les particularités des approches. Être Éducateur spécialisé en CMP n’a rien à voir avec Éducateur Spécialisé en MECS. Les approches sont différentes du fait des missions. Donc l’approche métier ne suffit pas à répondre aux enjeux de spécificités de l’intervention.
- Un projet centré sur l’aide sociale, à équilibrer avec l’action éducative
La mise en place de ces blocs de compétence apparait plus centrée sur les politiques publiques liées à l’aide sociale que sur l’action éducative. Il serait souhaitable que ces deux dimensions soient équilibrées dans la réforme. De plus, il est important de prendre en compte les attentes des services spécialisés qui emploient des travailleurs sociaux, tels que les services sociaux en entreprise, hospitaliers, de l’Éducation Nationale, ou des ministères tels ceux des armées et de l’économie qui emploient des milliers de professionnel(le)s. Quid aussi de la petite enfance. L’intervention en crèche ne vise pas que l’action éducative e n’entre pas dans les champs de l’aide sociale. Une fois de plus, on compartimente les champs puis les métiers.
L’approche proposée semble plus alignée sur la vision du travail social propre aux assistants de service social. Elle s’appuie sur une approche globale de l’évaluation et sur l’action collective de territoire. Les métiers dits éducatifs pourraient avoir plus de difficultés à s’y reconnaître, notamment dans des domaines comme la protection de l’enfance, où la notion d’autodétermination des familles peut soulever des questions complexes. La question d’auto-détermination des familles n’est pas atténuée dans le champ de la protection. Peut-être bien au contraire. En tout cas, elle concerne à minima le jeune accompagné dans son environnement de substitution « temporaire ».
- Une transition sans doute complexe
Cette nouvelle architecture nécessitera une adaptation conséquente des formations. Le passage d’une formation existante à une formation renouvelée peut s’avérer plus compliqué qu’il n’y parait. Il faudra aussi être vigilant : la mise en œuvre des blocs de compétence ne doit pas être une opportunité de regrouper les temps de formation dans une logique d’économie budgétaire. Cela irait au détriment de la qualité de l’enseignement. La généralisation des cours en amphithéâtre et en inter-filières pourrait engendrer des difficultés à court terme. Il ne s’agit pas de transformer la formation en suite de cours comme à la fac où chacun se débrouille comme il peut. Ce n’est pas la philosophie des centres de formation au travail social. La possibilité d’organiser plus de cours en « amphi » permettra certainement de dégager quelques marges de manœuvre pour travailler au plus près des spécificités. Les choix d’organisation relèveront du projet pédagogique de l’Organisme de Formation qui devra assumer les conséquences de ses choix. Aucun texte ne doit contenir/empêcher les dérives potentielles. Si la généralisation des cours en amphi et en inter-filière pourrait engendrer des difficultés elle peut aussi induire des opportunités. Donc à chaque OF d’assumer ses choix pédagogiques.
Un autre point de vigilance concerne le risque de perte de la méthodologie d’intervention propre à chaque métier. Il parait essentiel de préserver la diversité des formations et des approches, car c’est précisément cette diversité qui permet de répondre efficacement aux différentes problématiques et attentes des usagers. À l’image des métiers du bâtiment, où différentes spécialités sont nécessaires pour construire une maison, le travail social a besoin de professionnels aux compétences variées et complémentaires. C’est dit dans le texte : on parle de spécialités ou de compétences spécifiques. On peut donc avoir des professionnels avec des compétences spécifiques ou spécialités spécifiques, ce qui n’en fait pas nécessairement des professionnels différents (à l’image des médecins). Et nombre d’artisan ont une palette large de compétences qui dépasse celle de leur métier d’origine (le bâtiment souffre des mêmes maux que nos métiers). Et c’est le DTU qui permet de fixer les pratiques professionnelles, qu’elles soient réalisées par le plaquiste ou par le peintre.
- L’importance de la co-construction et de la communication
Pour assurer le succès de toute réforme, il est essentiel d’associer tous les acteurs du secteur, y compris ceux qui se montrent les plus réservés. L’objectif devrait être de trouver des consensus, quitte à modifier certains éléments décrits dans les blocs de compétence et les futurs référentiels. Cette pratique de co-construction est d’ailleurs un élément structurant de l’intervention en travail social.
Bien évidemment, il serait important aussi d’inclure les représentants des personnes accompagnées dans ce processus. Leurs points de vue sont essentiels pour s’assurer que le projet répond véritablement aux besoins des usagers des services sociaux. Rappelez-vous cette phrase attribuée à Nelson Mandela et reprise par ATD-Quart Monde : « ce qui se fait pour nous sans nous, se fait contre nous ». C’est du verbiage : heureusement que le législateur ne m’a pas demandé mon avis sur les compétences que doit avoir un maçon ou un carreleur. Cependant, ces derniers ont intérêt à faire ce que je souhaite s’ils veulent être payés.
La co-construction avec toutes les parties prenantes de l’intervention sociale va de nouveau nous conduire dans une bouillasse après de nombreuses heures de tergiversation : un consensus mou. Prenons appui sur les savoirs existants, la recherche produite sur le champ de l’intervention sociale. . Notre secteur et ce qui se fait à l’étranger est suffisant pour moderniser nos référentiels.
Toute réforme peut légitimement susciter des inquiétudes. C’est d’autant plus vrai dans le contexte actuel difficile pour les travailleurs sociaux et les structures qui les emploient. Il est primordial de mener une large communication et un travail d’explicitation pour éviter les interprétations erronées et les risques d’incompréhension. La transparence dans la démarche sera essentielle pour rassurer et valoriser les professionnels du secteur.
- Un projet à inscrire dans un contexte plus large
Il est important de noter que ce projet de réforme des réorganisations des formations au travail social pourrait apparaître comme secondaire pour certains acteurs du secteur. Il est surtout attendu des décisions plus pressantes telles que la revalorisation financière, la réponse à la crise du recrutement ou l’adaptation des dispositifs aux réalités du terrain. Cette évolution ne devrait pas être une initiative isolée, mais s’inscrire dans une démarche plus globale d’amélioration du secteur du travail social. Il faut aussi communiquer sur ce qui marche, sur ce qui fait du bien. Pour donner à voir ce que c’est et donner envie. Une vraie campagne de communication, à l’instar de celle engagée par l’État pour recruter ses militaires, produira de manière plus efficace un gain d’attractivité pour nos métiers de l’invisible.
Enfin l’envergure d’un tel projet justifie un portage politique fort et continu dans la durée. Un portage par une personnalité politique engagée et reconnue, telle que le président du Haut Conseil du Travail Social, pourrait permettre de répondre aux aléas liés aux changements d’orientation de politique sociale et aux changements de gouvernement. Pour autant, nous savons bien finalement que c’est le ministère qui décide en dernier ressort.
- Conclusion : une réforme plutôt cohérente, mais à mener avec précaution
En conclusion, cette refonte de l’organisation de la formation aux diplômes d’État du travail social apparaît cohérente au regard des évolutions actuelles des pratiques. Il apparait que tous les syndicats se sont opposés au projet pour diverses raisons lorsqu’elle a été présentée à la Commission professionnelle consultative (CPC). Si les syndicats ont raison, ce n’est à mon sens pas pour les bonnes raisons. Cette réforme va rajouter une énième couche de refonte. Faire perdre du temps et de l’énergie à tous. Pour aboutir au même résultat. Or, il paraît difficilement imaginable d’aller à l’encontre des représentants des salariés. Il serait incohérent de vouloir passer en force sans tenir compte de leurs avis et recommandations.
Un important travail d’adaptation et d’appropriation sera nécessaire, notamment dans le champ de la formation. Il faut garder à l’esprit que cette évolution ne pourra pas suffire à elle seule à renforcer l’attractivité et la reconnaissance des métiers du travail social. La réussite de cette réorganisation dépendra de sa capacité à préserver les spécificités de chaque métier tout en renforçant le socle commun de compétences, ainsi que de l’adhésion des différents acteurs du secteur. La réussite ne pourra être si l’idée de départ est mauvaise. Ou fondée sur des supputations. A-t-on fait une enquête « scientifique » sur ce qui fait défaut d’attractivité et ne facilite pas les évolutions professionnelles. A-t-on fait un sondage auprès des étudiants, des demandeurs d’emploi en reconversions, auprès des professionnels en poste ? Une fois de plus, ce sont quelques corps intermédiaires qui se croient au-dessus de la mêlée qui pensent avoir trouvé la solution et qui vont faire travailler les autres.
Appliquons au travail social (porté par la DGCS) les règles de la formation professionnelle (portées par le Ministère du Travail) : et déjà nous pourrons faciliter les évolutions professionnelles et renforcer l’accessibilité. L’attractivité reste un autre sujet.
Une fois de plus on se fabrique une conviction à partir de postulats qui ne reposent sur aucune approche « scientifique ».
En fin de compte, cette initiative témoigne d’une volonté de modernisation et d’adaptation du secteur aux réalités actuelles. Si elle parvient à atteindre ses objectifs tout en tenant compte des points de vigilance soulevés, elle pourrait contribuer à renforcer l’attractivité des métiers du social et à améliorer la qualité des interventions auprès des publics accompagnés. L’avenir du travail social dans notre pays se dessine ainsi à travers cette nouvelle architecture, porteuse d’espoir pour un secteur en quête de reconnaissance et d’efficacité.
N’oublions pas enfin que la formation d’assistant de service social est aussi mise en concurrence par les BUT option service social. Ce bachelor universitaire de technologie pourrait, sans formation complémentaire, donner accès au diplôme d’État d’assistant de service social (DEASS). Cette perspective défendue par la Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGesip) inquiète vivement les établissements de formation au travail social (EFTS) qui jusqu’à présent avaient en quelque sorte le monopole de la délivrance du diplôme dans le respect des exigences posées par le ministère des Solidarités (DGCS). Là aussi l’incertitude prévaut et l’UNAFORIS s’en inquiète fortement. La Licence Pro en protection de l’Enfance est du même ressort. Inquiétons-nous de ce qui se construit.
L’ADC vous invite à poursuivre ce débat en visio-conférence le lundi 26 mai à 16h30.
Alain HOTIER – Vice-président de l’ADC en charge de la formation
avec les collaborations de David DE FARIA – Directeur InKiPit et d’une contribution anonyme d’un adhérent